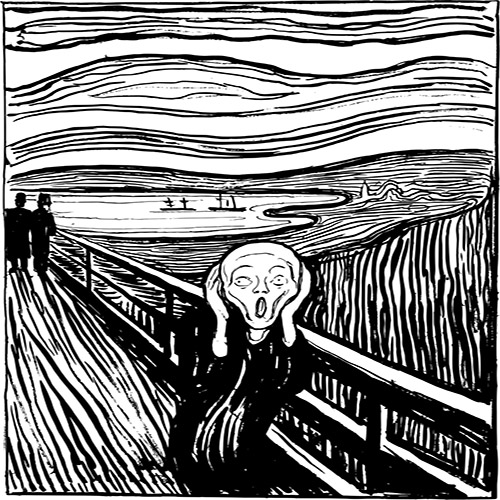Peur, anxiété, angoisse : qu’est-ce qui les différencie ? Quels sont les principaux troubles anxieux et leurs origines ? Comment les apaiser, avec ou sans accompagnement ?
Pour mieux comprendre ce que recouvrent les troubles anxieux et savoir comment les apaiser, il est essentiel de distinguer d’abord trois expériences proches mais différentes : la peur, l’anxiété et l’angoisse.
La peur
L’étymologie du mot peur est le latin pavor, qui signifie crainte ou effroi. Elle fait partie des six émotions de base que sont la joie, la tristesse, la colère, la surprise, le dégoût et enfin la peur. Cette émotion survient face à une menace réelle ou perçue. Elle est nécessaire et vitale en cas de danger, elle mobilise nos fonctions vitales pour fuir, combattre ou parfois rester figé sur place et ne plus rien ressentir.
Par exemple, si vous traversez la rue et qu’une voiture déboule à toute vitesse, la peur déclenche immédiatement une réaction de survie : accélérer, se figer, ou reculer. Le danger est concret et la réaction du corps proportionnée à ce qui se passe.
L’anxiété
Contrairement à la peur, qui répond à une menace précise et immédiate, l’anxiété est plus floue : elle se nourrit d’anticipations, de scénarios imaginés, d’incertitude. Elle s’accompagne de ruminations, d’hypervigilance et d’un sentiment de perte de contrôle.
Parfois, elle se manifeste sans cause apparente. On peut se réveiller avec une boule au ventre, le cœur qui s’accélère, une tension dans le corps, mais sans parvenir à dire pourquoi. C’est justement ce caractère diffus qui distingue l’anxiété de la peur : il n’y a pas d’objet précis, et pourtant l’organisme réagit comme si un danger était présent.
Elle mobilise les mêmes circuits que la peur (système nerveux autonome, amygdale, sécrétion de cortisol), mais de façon prolongée, ce qui peut engendrer fatigue, tensions musculaires, troubles du sommeil, palpitations.
L’angoisse
L’angoisse est une forme d’anxiété plus aiguë engendrant des manifestations physiques prononcées. Elle se distingue par son intensité et son impact physiologique plus fort. Selon son intensité, elle peut se transformer en attaque de panique. Elle peut prendre la forme d’angoisses existentielles comme la peur de la mort ou de la solitude.
Les troubles anxieux
Après avoir défini la peur, l’anxiété et l’angoisse, voyons comment elles s’expriment dans la vie quotidienne, parfois jusqu’à devenir envahissantes, à travers ce qu’on appelle les troubles anxieux.
Six troubles sont répertoriés dans les manuels de psychiatrie :
- Trouble anxieux généralisé (TAG)
Inquiétude excessive et persistante concernant de nombreux domaines de la vie quotidienne (travail, santé, famille…), difficile à contrôler et souvent accompagnée de tensions physiques (fatigue, troubles du sommeil, douleurs musculaires). - Trouble panique (avec attaques de panique)
Survenue répétée de crises d’angoisse soudaines et intenses (palpitations, souffle court, impression de perdre le contrôle ou de mourir). La peur de revivre une attaque de panique devient elle-même source d’anxiété. - Phobies spécifiques
Peur intense et irrationnelle face à une situation ou un objet précis (animaux, sang, avion, etc.), entraînant souvent l’évitement de cette situation au détriment de la qualité de vie. - Agoraphobie
L’agoraphobie se traduit par une peur intense de certaines situations où il serait difficile de s’échapper ou d’obtenir de l’aide en cas de crise d’anxiété intense ou d’attaque de panique. La personne peut se sentir piégée ou isolée, ce qui entraîne souvent l’évitement de lieux comme les transports, les espaces publics, les files d’attente ou certains environnements clos ou très ouverts (à ne pas confondre avec la claustrophobie, centrée sur la peur des espaces clos ; un ascenseur, par exemple, peut relever de la claustrophobie par peur de l’enfermement ou de l’agoraphobie par crainte de ne pas pouvoir fuir). - Anxiété de séparation
Peur excessive d’être séparé des personnes auxquelles on est très attaché. Fréquente chez l’enfant, elle peut aussi persister ou apparaître à l’âge adulte. - Anxiété sociale (phobie sociale)
Peur intense d’être jugé, humilié ou rejeté dans des situations sociales ou de performance (parler en public, rencontrer de nouvelles personnes, manger devant d’autres). Cette anxiété entraîne souvent évitement et isolement.
Les origines possibles des troubles anxieux
Certaines personnes présentent une prédisposition génétique ou biologique. Grandir dans un environnement marqué par l’anxiété peut avoir un effet de “contagion émotionnelle” dans les familles. Le système nerveux en garde une empreinte : l’amygdale cérébrale, petite structure du cerveau qui joue un rôle central dans la peur, peut s’habituer à fonctionner en mode « alerte » permanente, comme un détecteur de fumée trop sensible qui sonnerait au moindre signal.
À cela s’ajoute le terrain psychologique : le perfectionnisme, le doute constant, l’anticipation excessive ou l’hypervigilance sont autant de traits qui prédisposent à l’anxiété.
Les expériences de vie précoces sont à inclure également : insécurité affective, traumatismes, modèles familiaux anxieux… Tout cela contribue à l’installation d’un terrain anxieux.
En résumé, l’anxiété trouve souvent sa source dans une insécurité ressentie. Selon l’histoire de chacun, cette insécurité pourra ensuite se manifester sous différentes formes : trouble anxieux généralisé, attaques de panique, phobies, agoraphobie, anxiété de séparation ou anxiété sociale.
Comment s’apaiser soi-même ?
Comprendre le mécanisme des troubles anxieux est une première étape essentielle. Identifier ce qui se joue permet d’ouvrir la voie à une forme d’acceptation, car lutter contre ces réactions ne fait souvent qu’amplifier l’inconfort.
Un premier pas consiste à changer de regard : considérer le mécanisme anxieux non comme un ennemi intérieur, mais comme une protection. Ce réflexe a, à un moment de notre vie, joué un rôle utile : il nous a aidés à réagir face à un danger potentiel. Avec le temps, il s’est ancré et continue de s’activer même quand il n’est plus vraiment nécessaire. Mais il peut aussi garder aujourd’hui une fonction : celle de nous protéger de ce qui serait trop douloureux ou trop difficile à accueillir pour l’instant. Reconnaître à la fois cette fonction passée et cette utilité actuelle permet de regarder les troubles anxieux (peur, anxiété, angoisse) avec plus de bienveillance, et déjà d’en diminuer l’intensité.
Quand un trouble se manifeste et que vous avez l’énergie nécessaire, essayez de vous engager dans une activité simple (sport, marche, ménage, bricolage…). Cela aide à détourner l’attention de l’inconfort et en réduit l’intensité. L’important n’est pas de fuir, mais d’accueillir ce qui se passe tout en restant en mouvement.
Certaines pratiques favorisent un apaisement plus durable : yoga, cohérence cardiaque, méditation, ou simplement marcher dans la nature. En cas de crise aiguë, on privilégiera le mouvement (une marche méditative, par exemple) plutôt que l’immobilité d’une méditation assise : le mouvement aide à dissiper l’énergie accumulée.
Enfin, porter attention aux facteurs déclencheurs de ses troubles permettra, petit à petit, de modifier certaines habitudes et de retrouver un meilleur équilibre.
En thérapie
Certaines pratiques apportent un mieux-être au quotidien, mais la thérapie permet d’explorer plus en profondeur les mécanismes sous-jacents.
Le thérapeute formé à la psychopathologie est en capacité de repérer les troubles et de proposer un accompagnement ajusté.
En effet, le repérage du trouble a toute son importance, car l’accompagnement ne sera pas le même face à une phobie, une attaque de panique ou une anxiété sociale.
En Gestalt-thérapie, nous considérons l’anxiété comme une part de la personne et non comme une étiquette qui la définirait. Cette approche est particulièrement importante dans ce domaine : rien n’est plus anxiogène que de se sentir enfermé dans une pathologie.
L’accompagnement s’appuie sur plusieurs axes pour retrouver une sécurité intérieure et renforcer la confiance en soi, fragilisée par l’anxiété.
- explorer les sensations corporelles pour apprendre à les reconnaître et les apprivoiser,
- éclairer l’imaginaire, qui peut nourrir des scénarios toxiques,
- s’ancrer dans l’ici et maintenant, afin de réduire ruminations et anticipations.
En Gestalt, la relation thérapeutique joue un rôle central. L’anxiété apparaît souvent dans des contextes où la sécurité relationnelle a manqué. Retrouver, dans la rencontre thérapeutique, une expérience d’accueil et d’écoute constitue déjà une forme de réparation. Le travail se fait ensuite par petites expérimentations en séance, dans l’instant présent, pour redonner de la fluidité au cycle du contact1 et permettre au patient de se sentir plus libre dans sa manière d’être au monde.
Et les autres approches ?
La Gestalt-thérapie n’est pas la seule voie d’accompagnement. Les thérapies cognitivo-comportementales (TCC) sont également largement utilisées pour traiter les troubles anxieux. Elles se concentrent sur l’identification et la modification des pensées automatiques (ou pensées parasites) et des comportements qui entretiennent l’anxiété. Leur efficacité est bien documentée, notamment pour les phobies, les attaques de panique ou l’anxiété sociale.
Chaque approche a ses spécificités : la TCC agit surtout sur les symptômes en travaillant les pensées et les comportements, tandis que la Gestalt explore l’expérience globale de la personne — sensations, émotions, imaginaires, relation à soi et aux autres. Les deux approches peuvent d’ailleurs être complémentaires selon les besoins et les moments de vie.
Conclusion
Les troubles anxieux dans lesquels peuvent apparaître peur, anxiété et angoisse, prennent souvent racine dans l’insécurité ou dans des expériences marquantes, mais ils ne sont pas une fatalité. Les reconnaître, c’est déjà commencer à les apprivoiser. Et avec l’appui d’un travail thérapeutique, il devient possible de réduire leur intensité et de retrouver plus de paix intérieure.
1 Voir l’article « Le cycle du contact en Gestalt-thérapie : une clé pour mieux se comprendre »